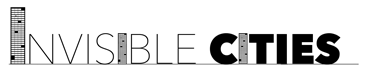Chez moi, trop de gens, trop de jeunes… Ils viennent s’alcooliser, se droguer. « La rue Chicago » dit la police. Chez moi. Ma cour bordée de déchets, d’épaves d’ivresse, de saletés, saletés. Et les sacs plastiques. Mes murs c’est des feuilles de cigarettes. Je suis mieux au Carrefour pas loin. Je pourrais planter une tente sur le parking ou je monterais une cabane que j’aurais achetée à Leroy Merlin. C’est calme. Je vois les gens passer. Des fois à ma porte, je pourrais écrire « épicerie sociale ». On frappe, on sonne. Dès qu’on a besoin de quelque chose. Dès que ça manque. Je ne sais pas quoi. Un peu de tout. On vient, on me demande. J’aime la nature, le calme. Je fais des dépressions hivernales. Mon gel du dedans. Je m’isole, je m’enferme. De septembre à février. Mon hiver est long. J’ai perdu beaucoup. Surtout des gens. Mes parents, mes frères. Des morts. Des tragédies. Plusieurs pendus. Trop de souvenirs. Parfois moi – mais vraiment je suis des fois plus bas que les trous de chaussettes. J’ai des angoisses comme raclées de vide qui m’emportent. Mes longs tsunamis. D’ailleurs, sept cent euros, la dernière facture d’eau. Et on ne trouve pas, on ne sait pas d’où vient la fuite. C’est pas possible. On n’est que deux. Mon fils. Moi. Sept cent euros c’est pas possible. Mes fils me surveillent. Pas pour l’eau mais pour les médicaments. Je pourrais me noyer dans les cachets. Tellement épuisée. Il n’y a pas longtemps, j’ai dormi deux jours. Mes longues nuits. Ça arrive des fois aussi, je ne peux pas manger. Mon docteur veut me mettre à l’hôpital. Moi non. Pas question. C’est comme une prison sans condamnation officielle. J’aime la nature – pas l’hiver, pas les feuilles qui tombent, les arbres dénudés, affamés. Ça me rappelle les morts dans ma famille. Tous en automne. Ma mère et ma grand-mère renversées. J’ai vu ma grand-mère, j’avais sept ans. Et mon frère, rupture d’anévrisme. Il conduisait son camion, il en percuté un autre. Je voudrais m’effacer. J’en suis pas loin. Je suis comme qui dirait « invisible ». Et pourquoi pas ? Tant mieux même. J’en ai besoin. Être trop ouverte, non. Je ne peux plus. C’est rude. Comme quand on ne se protège pas. Des moqueries, des jalousies, des méchancetés. Je sais que j’ai peur des gens maintenant. Je sais. C’est quand on essaie de fuir quelque chose. Je veux bien être là mais je voudrais qu’on ne me voit pas. On n’est jaloux seulement de ce qu’on voit. Effacez-moi. Continuez. Continuez-vous autres, qui me connaissez et qui faites comme si vous ne m’aviez jamais vue. Mais je vous ai aidés. Sincère… Et puis rabaissée, agressée. Des mots qui insultent, blessent, transpercent. Des mots qui restent sous la chair. En éclats. Qui me poussent au moins que rien. Quand j’aide quelqu’un, je n’espère pas de récompense. Seulement du respect. C’est quand même trop d’espoir. Je me sentirais plus considérée dans le mélange de l’air et des insectes. Papillon en voyage. Pour la beauté des couleurs dans la lumière. Avec ce silence qu’on s’accorde à soi-même. Cette armure de l’invisible, le silence. Se taire c’est un muscle mental. Sans se force ni à parler ni à rire. Sans ne jamais répondre à rien. Sinon seulement en battant des ailes. J’imagine cette saveur d’une autre solitude. Quand l’arrière-gout des jugements disparait. Comme un arôme acide qui ne revient plus, amer, mais enfin gommé des choses. Les autres m’étouffent parce qu’on m’a tellement rabaissée, réduite à rien. Mélangée dans la terre. Oui, papillon en voyage, ça m’irait bien. Et puis on aime les papillons.